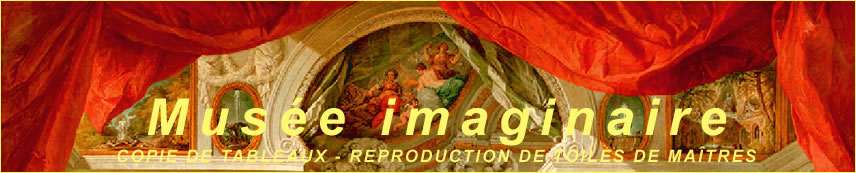Romantisme (art), dans le domaine des beaux-arts, mouvement qui a succédé au grand élan littéraire romantique de la fin du XVIIIe siècle en Europe du Nord et qui s'est développé dans toute l'Europe et aux états-Unis jusque dans les années 1850.
S'il ne peut être identifié à un style, une technique ou une attitude unique, le romantisme, notamment en peinture, affirme cependant son unicité à travers les thèmes dont il s'inspire : communion avec la nature dans ce qu'elle a de sauvage et de mystérieux, plongée dans l'inconscient, refus de toute visée moralisante, goût pour l'irrationnel, intérêt porté à l'époque médiévale. Alors que l'art classique ou néoclassique privilégie la clarté de l'expression et la retenue des émotions, l'art romantique cherche de façon caractéristique à exprimer par la suggestion, des sentiments intenses, mystiques ou fugitifs.
Le contexte du XVIIIe siècle
La sensibilité romantique ne s'est pas développée après le néoclassicisme et en réaction contre lui, mais bien parallèlement à celui-ci, dès le milieu du XVIIIe siècle. Caractérisée par le refus de toute moralisation au profit d'un goût prononcé pour l'irrationnel, cette sensibilité naît d'abord en Grande-Bretagne avec les poètes Edward Young ou encore William Collins et Thomas Gray. Elle se développe ensuite largement dans les littératures anglaise, allemande, puis française incarnée par l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. La poésie romantique apparaît en Allemagne et en Grande-Bretagne dans les années 1790 où le passage de la raison au sentiment et à l'imagination commence à se refléter dans les arts plastiques : illustrations visionnaires de William Blake, scènes fantastiques et cauchemardesques de Johann Heinrich Füssli, sombres gravures de monstres et de démons de Francisco Goya.
France
En France, la naissance du romantisme coïncide avec les guerres napoléoniennes (1799-1815). Les poèmes ossianiques de Macpherson, qu'apprécie particulièrement Bonaparte, livrent leurs thèmes aux peintres transfuges du néoclassicisme comme Girodet-Trioson, François Gérard et Antoine Gros, qui s'inspirent également des événements contemporains. Si Gros, dans une série de tableaux à la gloire de Napoléon, redonne à la couleur sa prééminence à travers la théâtralisation des champs de bataille, c'est avec Théodore Géricault que la vision romantique de la guerre, de la mort et de la folie prend les couleurs de la réalité la plus atroce (Cuirassier blessé quittant le champ de bataille, 1814, Musée du Louvre, Paris). Le Radeau de la Méduse (1819, Musée du Louvre) dépeint de façon paroxystique la souffrance humaine et l'inexorabilité de la destinée, thème qui trouve écho chez le peintre Eugène Delacroix, avec les Massacres de Scio (Musée du Louvre), tableau réalisé en 1824, l'année même de la mort de Géricault. Trois ans plus tard, le Salon de 1827 marque l'apothéose du romantisme en même temps qu'il porte à son comble la polémique à propos de l'esthétisme. Au raffinement exacerbé d'un François Gérard s'opposent la violence et l'érotisme de la Mort de Sardanapale (1827, Musée du Louvre) de Delacroix. Si cet artiste emprunte souvent ses sujets à la littérature, il s'attache à transcender ce qu'ils contiennent de littéraire ou de didactique en créant, par l'usage de la couleur, un effet d'énergie et d'émotion pures comparable à celui que procure la musique. Ainsi, rejetant la prépondérance accordée par les néoclassiques à la forme et aux contours, Delacroix s'accorde-t-il, avec la Mort de Sardanapale, inspirée d'une œuvre de lord Byron, une totale et entière liberté dans le traitement de la couleur ou la représentation des corps. Si la violence de la scène et son caractère mortifère — face à ses ennemis, le roi Sardanapale fait exécuter ses favorites puis se suicide — choquent les critiques, ils font cependant de cette œuvre la toile romantique la plus authentique de Delacroix. De nombreux artistes, comme Eugène Devéria (Naissance d'Henri IV, 1827, Musée du Louvre), Paul Delaroche (Jeanne d'Arc interrogée dans sa prison par le cardinal de Winchester, 1824, Musée des Beaux-Arts, Rouen), Léon Cogniet (le Massacre des Innocents, 1824, Musée des Beaux-Arts, Rennes), ou encore Horace Vernet, reprennent à leur compte la thématique romantique, mais restent à mi-chemin de la manière violente de Delacroix et de la sagesse classique d' Ingres, pour ne pratiquer finalement qu'un romantisme de « bon ton ».
Allemagne
à l'instar de la poésie et de la philosophie, la peinture romantique allemande puise ses sources dans l'idée d'une nature issue d'une manifestation divine. Elle donne naissance à une école de peinture de paysages symboliques, à l'origine de laquelle figurent les tableaux mystiques et allégoriques de Philipp Otto Runge. Le principal représentant de ce courant, considéré également comme le plus grand peintre romantique allemand, est Caspar David Friedrich , dont les paysages oscillent entre un subtil sentiment mystique et une impression de mélancolie, de solitude, voire d'aliénation. Son pessimisme romantique s'exprime le plus directement dans le Naufrage de l'espérance — la Mer de glace (1823, Kunsthalle, Hambourg), où l'épave d'un navire naufragé, à peine visible sur une pyramide de glace, apparaît tel un monument élevé au triomphe de la nature sur les aspirations humaines.
Les nazaréens, groupe d'artistes qui tentent de retrouver le style et l'esprit de l'art religieux médiéval, ouvrent une autre voie au romantisme allemand. Le principal représentant de celui-ci est Friedrich Overbeck. Parmi les artistes de la tradition romantique allemande figure encore l'Autrichien Moritz von Schwind, qui emprunte ses thèmes à la mythologie et aux contes de fées germaniques.
Grande-Bretagne
En Grande-Bretagne comme en Allemagne, les paysages où regorgent les émotions ou à Dimension métaphysique deviennent le principal mode d'expression de la peinture romantique ; les peintres britanniques innovent cependant davantage sur le plan stylistique et technique. Les paysages de Samuel Palmer se distinguent ainsi par une sorte de simplicité innocente, à laquelle est associé un sentiment religieux visionnaire, dérivé de Blake. John Constable , l'un des premiers peintres à travailler en plein air, s'éloigne cependant du sentiment d'une nature sauvage au profit d'une vision fraîche et calme, rendue par l'usage de couleurs lumineuses et d'une touche audacieuse. Le plus radical de tous les peintres romantiques est Joseph Mallord William Turner . Si ses premiers paysages rappellent ceux du Lorrain, Turner s'intéresse principalement dans ses œuvres postérieures aux effets atmosphériques de la lumière et de la couleur, mêlant nuages, brume, neige et mer en un tourbillon dans lequel tous les éléments se dissolvent.
états-Unis
Le paysagiste Washington Allston est l'un des premiers peintres à introduire le romantisme aux états-Unis, mais la manifestation la plus importante du mouvement reste incarnée par la Hudson River School, qui trouve son inspiration dans la brutalité sauvage des paysages du nord-est des états-Unis. Son chef de file, Thomas Cole, peintre d'origine anglaise, représente des forêts primitives et des montagnes élevées symbolisant la grandeur morale. Son élève Frederick Edwin Church adaptera le « style » de l'Hudson River School aux paysages de l'Amérique du Sud, de la Palestine et de l'Europe.
Le romantisme tardif
Vers le milieu du XIXe siècle, la thématique romantique est délaissée au profit d'autres sujets : d'une part, ceux caractérisés par un retour à l'Antiquité, et, d'autre part, ceux qui, glorifiant le quotidien humble et misérable en un genre noble, mettent progressivement en place les prémices du mouvement réaliste. Parmi les meilleures réussites du romantisme tardif figurent en France les paysages dits de l' école de Barbizon , avec Camille Corot et Théodore Rousseau. En Grande-Bretagne, les années 1850 voient l'apparition des préraphaélites, qui reprennent en quelque sorte à leur compte la « croisade médiévale » des nazaréens allemands.
Influence
L'influence icturale qu'a exercée, par ailleurs, le romantisme est certaine. On peut ainsi évoquer une filiation entre Constable et l' impressionnisme par l'intermédiaire de l'école de Barbizon ; mais l'héritier le plus direct du romantisme est sans doute le symbolisme qui reprend à sa manière la subjectivité, l'imagination et l'imagerie fantastique et onirique, propres au mouvement romantique.
© 1997 Encyclopædia Universalis France S.A.
Tous droits de propriété intellectuelle
et industrielle réservés. |